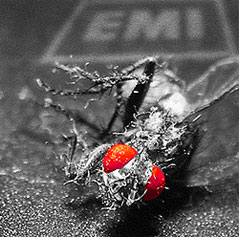 On aime à le rappeler parce qu’on l’oublie souvent : dans une société de labeur, vivre de la musique est un privilège et non un droit opposable. Vivre de son art est avant tout une chance matérialisée par une suite de concours de circonstances, et rarement le choix d’une carrière planifiée. C’est souvent un mélange des deux. Toutes les sociétés à tous les temps de l’Histoire ont eu besoin d’artistes et les ont fait vivre, ici par le mécénat, là par le commerce. Mais faire de l’art une industrie au point de faire de « l’industrie culturelle » une expression aussi banale que « l’industrie pétrolière » est une perversion toute récente, peut-être en voie de disparition, au moins en ce qui concerne la musique.
On aime à le rappeler parce qu’on l’oublie souvent : dans une société de labeur, vivre de la musique est un privilège et non un droit opposable. Vivre de son art est avant tout une chance matérialisée par une suite de concours de circonstances, et rarement le choix d’une carrière planifiée. C’est souvent un mélange des deux. Toutes les sociétés à tous les temps de l’Histoire ont eu besoin d’artistes et les ont fait vivre, ici par le mécénat, là par le commerce. Mais faire de l’art une industrie au point de faire de « l’industrie culturelle » une expression aussi banale que « l’industrie pétrolière » est une perversion toute récente, peut-être en voie de disparition, au moins en ce qui concerne la musique.
EMI, qui emploie environ 5.500 personnes dans le monde, a annoncé mardi qu’elle allait supprimer jusqu’à 2.000 emplois partout dans le monde, dans un plan qui prévoit d’économiser 200 millions de livres (265 millions d’euros) par an d’économies. C’est bien sûr l’effet mathématiquement froid de la vente d’EMI à un fonds d’investissement pour qui la seule œuvre d’art qui compte est l’oeil et la pyramide imprimés sur le billet vert. Parce qu’autant qu’elles soient détestées, les majors de l’industrie du disque étaient jusque là dirigées par des amoureux de la musique, parfois prostitués dans une vision uniquement commerciale de leur travail, mais toujours heureux de trouver la perle à produire. Avec Terra Firma, cette ère là est révolue. Le label doit d’abord faire de l’argent et toutes les décennies d’habitudes qui ont pourri financièrement les maisons de disques sont éliminées au Karsher du tableau Excel.
C’est à la fois la pire et la meilleure chose qui ait pu arriver à l’industrie du disque. Celle-ci a vécu près d’un siècle dans l’illusion qu’il était possible de vivre très confortablement de la vente de musique en travaillant le moins possible avec le maximum de notes de frais. Les meilleurs artistes (ou disons les plus chers), les meilleurs instruments, des sessions de studios qui coûtent des fortunes aux Etats-Unis ou (plus cool) dans une île des caraïbes… il y a une part de fantasme mais aussi une grosse part de réalité dans l’idée que l’on se fait de l’argent dépensé sans compter dans la production d’un album. Un album tous les deux ans, au mieux. « Impossible de faire plus », disent ceux de l’intérieur. Et quand les ventes baissent, on compense en augmentant les frais marketing qui, mécaniquement, doivent générer des ventes. Dans l’environnement d’extrême rareté médiatique qui a été celui du 20ème siècle, la recette fonctionnait bien. Même si un seul album sur dix s’avérait rentable (ce sont les chiffres généralement admis), tout allait bien dans le meilleur des mondes.
La fin d’une époque dominée par une poignée de médias
Jusqu’à ce que, patatras, la numérisation des médias et Internet viennent mettre fin à la rareté médiatique, à l’intermédiation obligatoire, aux situations d’oligopoles convenus. Le disco a fait place au blues.
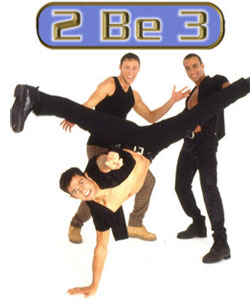 Seul le 20ème siècle et ses médias concentrés ont pu fournir le terreau de la construction d’une industrie de la musique fertile. Lorsque tout un pays écoute les mêmes chansons diffusées sur les mêmes médias et que seules ces chansons sont disponibles dans les mêmes chaînes de magasins… l’industrie prospère faute de diversité de choix et, surtout, de conscience d’une possibilité du choix.
Seul le 20ème siècle et ses médias concentrés ont pu fournir le terreau de la construction d’une industrie de la musique fertile. Lorsque tout un pays écoute les mêmes chansons diffusées sur les mêmes médias et que seules ces chansons sont disponibles dans les mêmes chaînes de magasins… l’industrie prospère faute de diversité de choix et, surtout, de conscience d’une possibilité du choix.
Jugez vous-même :
Il existe en France 959 radios différentes, la plupart locales et associatives, mais 20 stations seulement partagent 80 % de l’audience nationale. Chaque jour, la radio musicale la plus écoutée l’est par près de 6 millions d’auditeurs… trois fois le nombre d’habitants de la ville de Paris. Et sur cette station, les 40 chansons les plus diffusées représentent 70 % des diffusions. Sur toute une année, 12 mois, 365 jours, elle diffuse à peine plus de 2000 chansons différentes, dont certaines peuvent être diffusées jusqu’à 9 fois par jour. Et ça n’est pas un record. En 2006, la radio locale Vibration a diffusé jusqu’à 178 fois par semaine la même chanson… soit plus d’une fois par heure ! En mettant bout à bout l’ensemble des chansons diffusées sur l’ensemble des radios françaises, il n’a été diffusé en 2006 que 61.778 titres différents. C’est moins de 1 % de ce qui est disponible sur la boutique de musique en ligne iTunes.
Si vous êtes une maison de disques, faites entrer un seul disque dans la playlist de ces quelques radios nationales, et vous êtes sûrs de surcompenser toutes les productions qui ont été des flops. Depuis des décennies, l’industrie fait bon gré mal gré avec cette politique du star system et de la vache à lait, qu’elle critique mais dont elle s’accomode volontiers. L’industrie du disque est probablement l’une des seules industries qui pouvait jusqu’à récemment se permettre de voir 90 % de ses produits être déficitaires. Et de trouver cela totalement normal, et même de le revendiquer, au nom de la diversité culturelle.
Cet âge d’or-là est fini. Avec Internet, même si les choses se font lentement, la déconcentration de l’offre musicale est en marche, et les médias doivent affronter une concurrence au nombre illimité. Le paradigme économique est totalement chamboulé. Le piratage, pointé du doigt depuis les années 1990, n’est qu’un microphénomène pour expliquer la chute de l’industrie. Piratage ou non elle est inéluctable, car ses bases fondamentales reposaient sur un marché artificiellement raréfié. Le terreau est mort, il s’est épuisé et la mort de l’industrie (telle qu’elle fut) est inévitable.
Le plan social déclenché par Terra Firma met fin à cette période d’insouciance et ramène à la douloureuse réalité ; vivre de la musique est un privilège très difficile à entretenir. Renforcer encore le droit d’auteur pour maintenir ce fantasme, c’est poser des digues de bois contre un tsunami.
La vente de la musique enregistrée est morte. La musique, elle, restera toujours vivante. Mais au 21ème siècle, vivre de la création musicale devrait être aussi rare, difficile et privilégié que pendant tous les siècles qui ont précédé le 20ème. Et ceux qui en vivront gagneront probablement des fortunes bien moindres que ces méga-stars des années 1980.
+ rapide, + pratique, + exclusif
Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.
Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.
Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci
Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.
C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.
Mais si vous le pouvez,
voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :
- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.
- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.
- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.
Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil
Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !
















