Elon Musk aime les enfants. Plus exactement, il aime l’idée d’en avoir beaucoup. Le nouveau dirigeant de Twitter a déjà été père dix fois (officiellement) avec trois femmes différentes. Il est fasciné par la figure de Gengis Khan, guerrier sanguinaire et fondateur de l’empire mongol connu pour ses nombreux descendants, au point de nourrir une rumeur invérifiable sur la présence de ses gènes chez 8 % des hommes d’Asie du Nord. L’obsession d’Elon Musk pour la reproduction n’est d’ailleurs pas un secret. Depuis des années, il dénonce publiquement le déclin supposé de la civilisation à cause de la baisse du taux de natalité (une théorie qui a été démentie à de nombreuses reprises par les démographes, et qui va généralement de paire avec le complot raciste du « grand remplacement »). Ces idées sont très populaires auprès de l’extrême-droite (en France, Eric Zemmour ou Michel Houellbecq évoquent souvent le sujet de la natalité). Elles sont aussi partagées, plus discrètement, par un petit groupe de personnalités du numérique.
C’est ce qu’on apprend dans cette longue enquête (en anglais) publiée la semaine dernière chez Business Insider, dédiée au mouvement pro-nataliste au sein de la Silicon Valley. Pour ses adeptes, il faut faire beaucoup d’enfants et surtout investir dans des nouvelles technologies pour « réinventer la reproduction » : aide à la fertilité, conception d’utérus artificiels, tests génétiques sur des embryons, etc. Le mouvement est logiquement accusé d’eugénisme à la sauce startup. Il s’agit non seulement de se reproduire « mieux », mais surtout de favoriser les projets d’enfants des « bonnes personnes » pour sauver le monde, c’est-à-dire les plus intelligentes (selon leur définition) et suffisamment riches pour s’offrir toutes ces technologies, accéder à des structures type écoles privées ou même un étrange projet de « ville start-up » réservée aux entrepreneur·es et à leurs progénitures.

Franchement flippant ! Et pas franchement étonnant. Nous avons longtemps vécu avec le cliché du nerd « apolitique », qui ne s’intéressait qu’à son domaine d’activité. On s’est bien rendu compte à la longue que c’était faux : déjà parce que le numérique est politique, mais aussi parce que ces fameuses activités ont bouleversé de nombreux aspects de notre quotidien et de nos lois. Mais ces dernières années, plusieurs personnalités de la Silicon Valley ont franchi une étape supplémentaire. Elles ne s’intéressent plus seulement à leurs produits et l’écosystème législatif qui les contraint (ou non). Elles veulent modifier, plus généralement, notre société. « Ces investisseurs en ont marre de disrupter des entreprises, maintenant leur objectif, c’est de dynamiter nos structures sociales et gouvernementales », résumait Del Johnson, lui-même investisseur et régulièrement critique de ses pairs sur son compte Twitter.
Ce mouvement est très visible chez Elon Musk, qui tweete à tout bout de champ sur le « futur de la civilisation » et le rôle qu’il aurait à y jouer avec Twitter (je vous recommande d’ailleurs la lecture de cet article du Monde qui résume bien la bulle ultraconservatrice dans lequel il évolue actuellement). Il ne s’agit pas que de se battre pour une certaine conception de la liberté d’expression. Peter Thiel, cofondateur de PayPal et investisseur éminent de la Silicon Valley, finance depuis longtemps les hommes et femmes politiques américain·es qui représentent ses idées populistes, nationalistes et climatosceptiques. David Sacks, autre ancien de Paypal et conseiller d’Elon Musk dans le rachat de Twitter, croit en l’effondrement de la démocratie. Palmer Luckey, créateur de l’Oculus Rift et précurseur de la réalité virtuelle, rêve désormais de la suprématie militaire de l’Occident et affiche ouvertement ses idées anti-immigration. Sam Bankman-Fried, ancienne star déchue de la crypto, et d’autres élites de la tech se revendiquent « altruistes efficaces ». Selon cette philosophie, « les ultra-riches sont des rouages essentiels de l’amélioration du bien commun », nous explique Numerama, et le potentiel du futur compte davantage que les problèmes du présent, comme le réchauffement climatique et les inégalités économiques.
La liste est longue, et comporte aussi des personnes qui n’expriment pas publiquement leurs opinions. Elle nous force à réfléchir à qui l’on a admiré dans l’industrie du numérique et pour quelles raisons on les admire encore, car on ne peut pas séparer l’entrepreneur de la politique. On a longtemps cru que les nouvelles technologies représentaient le futur. Peut-être qu’on avait raison. Mais finalement, de quel futur parle-t-on ?
La revue de presse cette semaine
Game over
On a déjà parlé ici de l’intersection du deuil avec les nouvelles technologies. Cet article de Vice se penche plus particulièrement sur l’expérience de la perte au prisme des jeux vidéo, et la sortie de nombreuses expériences vidéoludiques dédiées à la mort ces dernières années. C’est à lire par ici.
Deepfakes
Le problème des deepfakes pornographiques est désormais bien connu, mais embarrasse encore professionnels du numérique et régulateurs de tous les pays. En Grande-Bretagne, ils pourraient bientôt être officiellement punis, grâce à un amendement à un projet de loi, le Online Safety Bill, qui doit être examiné par le Parlement anglais, début décembre. Ce dernier porte plus généralement sur la régulation des plateformes en ligne et est critiqué pour certains aspects par des associations de défense de la vie privée. Vous pouvez en lire un résumé (en anglais) sur le site du Guardian.
Qui est-ce ?
La voix de lecture automatique de TikTok appartient bien à une vraie personne : il s’agit de Kat Callaghan, animatrice de radio canadienne, qui a été interviewée par The Verge sur son expérience. J’aurais bien aimé que l’entretien aille un peu plus en détails sur certains sujets, mais je suis en général fascinée par les enjeux de voix utilisées par les nouvelles technologies, donc j’ai quand même trouvé ce témoignage intéressant ! Il est à lire (en anglais) chez The Verge.
I want it that way
Comment apprend-on à coder aujourd’hui, et hier ? Et y a-t-il des expériences qui comptent plus que d’autres ? Voici les questions qui taraudent l’autrice de cet édito, publié chez Slate, à propos de son expérience à développer un site en HTML dédié aux Backstreet Boys à la fin des années 90. C’est à lire (en anglais) par là.
Quelque chose à lire/regarder/écouter/jouer
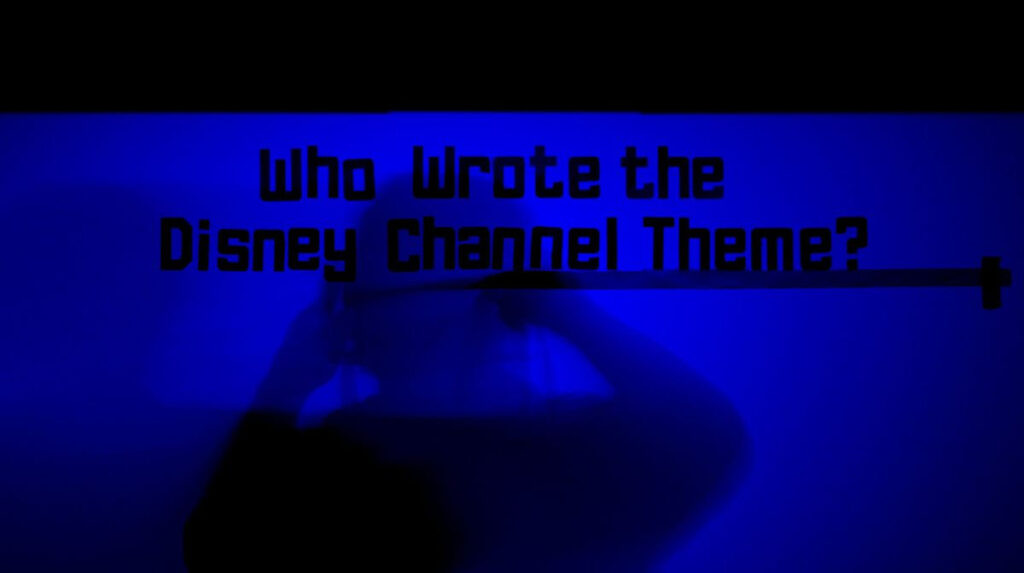
Je suis fascinée par les parcs d’attraction. Pourtant, je n’en fréquente pas tant que ça ! Je suis allée à Disneyland Paris davantage adulte qu’enfant (nous étions une famille Nigloland), et ces lieux ne me sont donc pas spécialement nostalgiques. Mais ils m’intéressent pour plein d’autres raisons. Parce qu’ils sont souvent à la pointe de la technologie, pour leur poids économique et médiatique, parce que je prends très au sérieux les divertissements, et pour ce qu’ils disent de nous et de notre société.
J’étais donc la cliente idéale pour Defunctland, une série de courts documentaires diffusée depuis 2016 sur YouTube, dédiée aux parcs d’attraction et plus généralement au divertissement grand public. Son auteur, le documentariste Kevin Perjurer, s’intéresse plus particulièrement aux erreurs de cet écosystème : pourquoi Disneyland Paris a-t-il été un échec avant même son ouverture ? Y a-t-il toujours eu autant de queue dans les parcs d’attraction ? Cette attraction Garfield est-elle vraiment hantée ? Le génie de Defunctland est de retenir l’attention grâce à un sujet d’apparence léger, puis de dérouler les enjeux très sérieux (culturels, socio-politiques, économiques) qui s’y cachent. Qui aurait cru que je serais émue par un documentaire d’une heure et demie sur l’auteur·e inconnu·e du thème musical de Disney Channel ?
Defunctland, sur YouTube, sous-titres en anglais disponibles
+ rapide, + pratique, + exclusif
Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.
Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.
Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci
Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.
C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.
Mais si vous le pouvez,
voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :
- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.
- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.
- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.
Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil
Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !
















