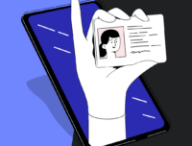À 27 ans, Juan Branco a déjà mené de nombreux combats : contre Hadopi, pour Julian Assange et Wikileaks… Aujourd’hui, il porte les couleurs de la France insoumise aux législatives, en tant que candidat dans la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis.
Il revient, pour Numerama, sur l’origine de son engagement auprès de Jean-Luc Mélenchon, sa manière originale de mener campagne en tant que quasi-novice de la politique, les enjeux actuels du numérique, ses désaccords majeurs avec Emmanuel Macron, le paradoxe Uber pour l’emploi, son futur avec Wikileaks ou encore les défis qui l’attendent en cas d’élection à l’Assemblée nationale.
Votre engagement pour Julian Assange et Wikileaks vous a-t-il posé un problème pratique avant l’annonce de votre candidature ?
C’était une question compliquée Je me suis même demandé s’il fallait que j’annonce publiquement que j’arrêtais [d’être l’un des conseils de Wikileaks] avant la campagne. Et en même temps, je me présente devant les électeurs avec — en partie mais pas complètement — ça, qui fait partie des choses qui m’ont légitimé. D’un autre côté, demain, si je perds l’élection et que j’ai une activité professionnelle à nouveau, je serai avocat. Il n’y a pas de réponse évidente.
J’ai eu très peur et j’ai encore parfois le sentiment de ne pas faire le bon choix. C’est un vrai sujet, surtout quand Julian me fait le grand plaisir, au lendemain de mon annonce de candidature, de faire ses tweets sur les Macron Leaks (rires).

En novembre 2016, J. Branco défend WikiLeaks sur CNN, il est alors interrogé sur le biais pro-Trump de l’organisation par la presse américaine
Vous avez travaillé auprès d’Aurélie Filippetti puis de Laurent Fabius : peut-on considérer votre engagement actuel avec Jean-Luc Mélenchon comme une forme de rupture avec le Parti socialiste ?
J’ai été recruté par Aurélie Filippetti en 2012 parce que je m’étais engagé sur la question d’Hadopi de façon assez forte comme citoyen, en montant une association avec la Quadrature du net, l’ISOC [Internet Society] et l’UFC-Que choisir, et en réussissant à faire tomber le premier vote de la loi Hadopi.
À partir de cette expérience, je monte une organisation qui mêle artistes, citoyens et sociétés d’auteurs. On continue notre lutte pour essayer d’élaborer une licence globale et moi, par ailleurs, j’écris un livre sur le sujet [Réponses à Hadopi, Capricci, 2011]. Aurélie Filippetti me recrute en novembre [2011] parce qu’elle […] s’en tient à cette proposition de Hollande de supprimer l’Hadopi et de proposer une alternative, a priori une forme de licence globale.
Je suis donc chargé, dans cette campagne, d’élaborer cette alternative, ce qui me donne un rôle très important au final, puisqu’il s’agit en fait de la réforme de toute l’industrie culturelle. Mais à aucun moment je ne suis encarté ni ne fais la campagne positivement : je suis en charge de la partie programmatique de quelque chose qui va être abandonné au cours de la campagne et entraîner mon éjection.
Je ne me suis jamais senti attaché au Parti socialiste en général et en particulier à ces personnes-là, pour lesquelles je n’ai pas forcément une grande estime.
On me propose un poste de chargé de mission au ministère de la Culture à 4 000 euros par mois que je refuse, parce que c’était le prix de mon silence. Je révèle ensuite à Mediapart qu’il y a eu trahison et renoncement de la part de François Hollande — sous pression des lobbys — et d’Aurélie Filippetti — pour obtenir son poste de ministre de la culture et s’adapter à la nouvelle ligne choisie.
Après ça vient une période où je pars en Afrique centrale pour enquêter au sujet de ma thèse et d’un article pour Le Monde diplomatique. Puis le quai d’Orsay m’appelle — pas du tout via des réseaux de la campagne — pour travailler sur les droits de l’homme et de la justice internationale auprès du ministre, Laurent Fabius, mais je n’ai jamais été en rapport avec lui. Je ne me suis jamais senti attaché au Parti socialiste en général et en particulier à ces personnes-là, pour lesquelles je n’ai pas forcément une grande estime.
Comment votre parcours a-t-il fini par croiser celui de Jean-Luc Mélenchon ?
Par une rencontre en mars 2016, lorsqu’il me propose de le rejoindre après avoir entendu parler de mon engagement pour Wikileaks et ce que j’avais fait auparavant. Pour ma part, je lui montre clairement que je suis un peu un traumatisé de la politique, en particulier après ce qui s’est passé avec Aurélie Filippetti, et que je ne suis pas du tout prêt à m’engager.
C’est seulement en novembre, quand je vois que la situation politique devient vraiment catastrophique, avec Fillon qui gagne les primaires de droite, Valls qui est donné favori pour les primaires de gauche et Macron qui est en train de monter, que je me dis que je peux pas rester attentiste. J’accepte de lui réécrire pour lui dire que je veux bien qu’on se rencontre. On se voit pendant 5 heures, il me fait une sorte de checkup programmatique sur tous les points pour voir ce que je pense sur tous les sujets.
Et après il me dit : « Écoutez, dites-moi ce que vous voulez faire, sur la position publique ou privée, on a envie de travailler avec vous ». Là j’y suis allé encore à reculons et, la campagne aidant, le discours de Marseille en particulier qui me fait pleurer comme une madeleine, me fait dire que je suis vraiment prêt à prendre position pour ce programme et ces idées. Jean-Luc Mélenchon me propose alors d’aller aux législatives et je demande à aller à Clichy-sous-bois.
Qu’est-ce qui vous a particulièrement marqué dans le discours de Marseille ?
C’est un discours sur l’immigration donc la capacité à renverser la parole, alors qu’on est dans une période extrêmement violente sur ces sujets, et à rendre hommage à ces personnes qui sont mortes en Méditerrannée. Moi, ça touche une affaire personnelle puisque mes parents ont fui les dictatures, en Espagne et au Portugal, pour venir en France. […] Entendre un politique français parler avec ce rapport à la langue — pour moi c’est le plus important –, si respectueux, si fin de ces sujets, et parler en notre nom, c’est un moment extrêmement fort.
À Clichy-sous-Bois, je remarque d’ailleurs quand je parle avec les gens, et notamment les mamans dans les marchés, qu’elles en parlent encore avec émotion : elles ont été émues par ce moment où il a parlé d’elles et de ce qu’elles ont traversé, de ce que ça représente de partir en exil d’un pays, volontairement ou pas.
C’est un peu la trajectoire de Mélenchon et je pense qu’on a beaucoup accroché là-dessus : lui, il est né à Tanger, moi je suis né en face de l’Espagne, en Andalousie, mais vraiment en voyant le Maroc depuis chez moi. Il y a un rapport à ces sujets qui est presque intime.
Avec Wikileaks vous portez la voix d’une organisation de manière plus ou moins directe. Mais son discours est très critique envers les institutions politiques : cet engagement marque-t-il une rupture avec cette philosophie ou est-ce au contraire un devoir de Wikileaks de participer aux institutions qu’il critique ?
Je ne pense pas que je suis en train de m’institutionnaliser en rentrant en politique. J’y vais dans un cadre mais surtout en étant moi-même, en essayant de maintenir ce rapport de rupture au politique, de la même façon que je n’ai pas du tout accepté de m’intégrer au système avec Aurélie Filippetti en faisant ce qui est à mon avis un parcours initiatique pour les politiques.
Il s’agit de faire une sorte de bargain [marché] où on vous propose à renoncer à une partie ou à la totalité de vos idées en échange d’une récompense et on voit si vous acceptez pour voir si vous êtes suffisamment docile pour rentrer dans une forme de moule. À l’époque, j’avais 22 ans : si on accepte à cet âge-là de rentrer là-dedans, à partir de là, on ne fera rien de sa vie. J’ai eu cette chance de résister à ce moment-là, ce qui m’a amené à travailler avec Wikileaks mais je considère que c’est toujours la ligne que je suis.
Quand Jean-Luc Mélenchon me donne sa confiance personnelle pour tenter de devenir député, j’ai cette chance d’être dans ce rapport-là, hors de toute politique partisane ou de lutte d’appareil. Je n’ai pas de lien d’affiliation particulier, j’ai gagné cette place parce que j’ai fait des choses que certains, en particulier Jean-Luc Mélenchon, considéraient importantes auparavant. Et à partir de là je méritais d’avoir sa confiance. Il n’y a pas d’allégeance ni de soumission à un système. Quand il me propose ça, il sait qu’il ne va pas me tenir.

« Pourquoi ? » Le 27 octobre 2005, date du décès de Zyed et Bouna, est devenu une cicatrice de Clichy. CC Cicilie Fagerlid
[…] Si je choisis Clichy-sous-Bois, qui est l’une des communes les plus pauvres de France, c’est aussi pour tenir cet engagement alors qu’on m’a proposé d’aller ailleurs, dans le Sud de la France, avec des circonscriptions beaucoup plus facilement gagnables. M’imposer d’aller dans un endroit très difficile où il y a, symboliquement, quelque chose de très fort, avec l’affaire Zyed et Bouna, sur laquelle j’avais travaillé, c’est un moyen de me dire que je ne ferai pas de compromis. J’y vais pour porter la parole de personnes qui ne me pardonneront pas si à un moment je m’installe.
Projetons-nous dans deux ou trois ans : si le président réussit son pari politique, on risque d’avoir la mandature la plus godillot jamais connue. Ça ne vous fait pas peur ?
Il y a une grande fragilité dans la position de député. […] La première chose, c’est d’essayer d’avoir un poste important au sein du groupe parlementaire, d’institutionnaliser ma place dans ce système. C’est-à-dire en ayant une place un peu plus forte qu’un député primo-accédant, en faisant valoir mon expérience, etc.
L’autre chose, c’est de réussir à incarner ce que je peux incarner symboliquement pour les médias et mon accès aux médias nationaux pour que ma parole puisse avoir un poids politique immédiat et résonne suffisamment pour provoquer des ruptures. Ça va être une lutte permanente et c’est très sacrificiel puisqu’il faut aller à la fois contre le système et contre les intérêts immédiats, les calculs politiciens, les compromis, etc.
Ce n’est évidemment pas gagné. Ce que je veux faire, c’est pousser au plus loin la limite et si ça rompt, tant pis pour moi. […] C’était pareil avec Aurélie Filippetti : j’ai proposé un truc, on a fait 250 auditions, j’ai rencontré tous les PDG de France Télévisions, TF1, à un âge où ça aurait pu me griser et où j’aurais pu me dire : « Voilà, c’est mon avenir, je vais rester là-dedans ». Mais non, j’ai joué de ça pour pousser la rupture au plus loin cet appareil, qui était le Parti socialiste, dans sa capacité à porter des idées différentes, et ça a rompu parce qu’à un moment l’appareil est plus fort que toi, surtout quand tu as 22 ans.
L’idée est la même : on pousse au plus loin et au pire, si ça échoue, on aura essayé et le côté éthique sera préservé. Et sur le travail législatif, beaucoup moins visible, il y a des députés d’opposition qui ont fait un travail magnifique et honnête, comme Isabelle Attard. […] Si on combine les deux, ça peut avoir un sens. […] Je sais que ce n’est pas du tout gagné, je suis dans une circonscription qui penche à droite. […] Il faudrait que je subvertisse la dynamique nationale au niveau local, ce qui est quasiment impossible. En tout cas, la démarche est celle-là.
Par votre parcours, vous incarnez vraiment la démarche « société civile ». Auriez-vous accepté de vous présenter pour Emmanuel Macron et La République en marche ?
Ils m’ont fait plusieurs propositions, à 3 moments différents. La première très tôt, alors qu’Emmanuel Macron était au secrétariat général de l’Élysée. Ensuite, avec Laurent Bigorne, le président de l’Institut Montaigne, qui m’avait rôdé, et finalement avec Nadia Marik, l’ancienne femme de Richard Descoings, avec qui j’ai travaillé, et là il était question de la députation.
l’individualisme forcené d’Emmanuel Macron
Emmanuel Macron représente exactement l’inverse de ce qui me semble devoir être l’engagement politique. C’est quelqu’un qui a construit toute sa carrière pour se servir lui-même. Il n’y a pas un geste dans sa carrière, même depuis l’adolescence, où vous voyez un geste fait pour l’autre. C’est en permanence une sorte d’accumulation de privilèges. Dès 2012, j’ai été en rejet par rapport à ce qu’il incarnait, j’ai écrit des textes sur ce qu’il était, et je trouve que son parcours personnel rejoint son discours politique. Quand il dit qu’il faut que les jeunes français puissent rêver d’être milliardaires, c’est pour moi l’inverse de ce que devrait être un discours politique.
Il ne faut pas rêver d’être milliardaire, c’est-à-dire devoir se protéger du reste de la société et s’assurer qu’enfin on aura un capital tel qu’on n’aura peur de rien. Il faut effectivement désactiver ces peurs mais en créant une société suffisamment solidaire pour faire que, même si l’on n’est pas milliardaire, on ne s’effondrera jamais : il y aura toujours une main tendue qui nous permettra d’être inséré socialement, de ne pas souffrir, etc.
Pour moi, il y a l’individualisme forcené d’un côté, qu’Emmanuel Macron représente […] et de l’autre la tentative de construction d’un espace public qui soit sain et protège y compris les plus fragiles. […] Je pense que sociologiquement, tout me poussait vers Emmanuel Macron. Beaucoup de mes camarades de promo de Sciences Po, de Normale, etc, sont rentrés dans les rangs. Ils vont devenir députés parce qu’ils ont obtenu des circonscriptions où ils sont déjà tellement en tête qu’ils vont gagner sans faire campagne mais si j’étais rentré dans ce dispositif […] ça aurait été un évidement de mon capital symbolique que j’ai pu construire avec Hadopi, Wikileaks, etc, au service d’une place, d’un poste bien payé mais j’aurais été un député godillot.
Regrettez-vous de ne pas avoir conclu d’accord avec le Parti communiste pour une candidature en commun aux législatives ?
J’ai beaucoup regretté mais je pense honnêtement qu’ils ont reçu des consignes, une directive du national leur demandant de ne pas faire d’accord. La campagne qu’ils font contre nous est triste. […] Je respecte le fait qu’il y ait plusieurs partis de gauche qui se présentent, je n’ai jamais été un forçat de l’union. Le Parti communiste a fait un travail extraordinaire en banlieue, notamment sur la culture et l’éducation populaire, et s’il estime qu’il est légitime de se représenter, qu’il le fasse.
Ce sont des enjeux politiciens. […] J’ai proposé un accord aux communistes, qui respectait toutes les conditions demandées. […] Ce qui m’attriste c’est que ce soit entré dans le débat public : s’il y a accord, on se lance, sinon tant pis. Mais ça ne devrait pas devenir un enjeu de débat public, où chacun dit quelque chose qui est contredit par l’autre et où on ne sait plus qui croire. Mettre en avant ces divisions d’appareil, je trouve que ça pollue l’espace public et que ça ne sert à rien. […]
Vous menez campagne de manière atypique, en vous filmant sur le terrain : aviez-vous prévu ce mode de communication à l’avance ou il s’est improvisé en pratique ?
Je pense que ça s’est vraiment imposé comme une façon différente de partager d’une façon différente sur la forme et le fond, au-delà du fait de se filmer en selfie. C’est une façon de montrer de façon très directe ce qu’est la politique, et un moyen de montrer sa différence. On n’est pas sur une communication institutionnalisée avec des tracts et des affiches.
On essaye de parler directement avec le moyen le plus accessible et le plus horizontal possible : c’est la vidéo, moi qui parle à un téléphone portable. Tout le monde pourrait faire la même chose. Ça casse un peu ce côté vertical du politique qui impose une parole solennelle à l’autre et je pense que ça intéresse un peu les gens de voir un peu les sentiments… même si j’essaye toujours de mettre en valeur un thème particulier, ils voient un type lambda qui rentre en politique et comment on opère.
Comment parlez-vous numérique avec vos électeurs potentiels ?
On parle très localement fibre optique parce que c’est un enfer. On parle, à Clichy-sous-Bois, de 3G ou 4G parce que tout Clichy-sous-Bois est chez Free et en 3G encore. Vous avez des problèmes de connexion Internet et les câbles de fibre optique n’arrivent pas dans les barres [d’immeuble], quand ce n’est pas l’ADSL qui fonctionne mal.
[…] On se retrouve dans un territoire où vous êtes super isolé, qui, en plus de cet enclavement territorial, subit un enclavement communicationnel. Vous n’avez pas d’infrastructure qui permettrait de compenser a minima ce problème. Rien que ça, c’est une façon d’en parler.
Évidemment qu’Hadopi est un enjeu fondamental pour la jeunesse mais il n’amène pas à un vote donc je ne me présente pas comme « M. Hadopi »
Là, on essaye d’organiser une visioconférence avec Julian Assange pour montrer à Clichy-sous-Bois qu’il s’intéresse à eux et peut communiquer avec eux. Ce qui parle plus dans mon parcours [aux électeurs potentiels], c’est plus mon engagement pour des personnes dans des thématiques risquées, comme Assange ou Zyed et Bouna.
Hadopi, je n’ai même pas besoin d’en parler : il n’y a pas de Fnac à 50 km à la ronde, et avec les connexions Internet pourries, [les habitants] téléchargent comme ils peuvent, en torrent, parce que si vous êtes en téléchargement direct ça coupe. Évidemment que c’est un enjeu fondamental pour la jeunesse mais il ne va pas amener à un vote donc je ne vais pas arriver comme « M. Hadopi ».
Pour le coup, je vois comment ma lutte contre Hadopi a pu avoir du sens sur un territoire comme celui-là où il n’y a pas d’accès à des infrastructures culturelles et où l’absence d’Internet est une catastrophe.
Uber est un sujet délicat en banlieue : l’entreprise offre du travail dans les zones difficiles mais dans des conditions d’exercice décriées. Comment abordez-vous ce paradoxe sur le terrain ?
C’est pour moi un exemple clair de disruption technologique : nous pouvons réguler mais il faut accepter qu’un modèle va changer. Celui des taxis est logiquement impacté par la transformation technologique. Je me souviens que ce fut une de mes premières discussions avec Jean-Luc Mélenchon, il savait que politiquement c’était délicat. Je lui avais alors dit : « Vous ne vous rendez pas compte de la grogne qui monte chez les chauffeurs Uber à cause des conditions de travail » La férocité du système Uber touche ceux qui sont en bas de la chaîne, ce sont ceux pour qui l’État n’intervient pas assez qui souffrent de la disruption.
Uber fut une de mes premières discussions avec Jean-Luc Mélenchon
Vous pouvez considérer en effet qu’Uber amène du travail et propose une violence moins grande que celle du chômage. Ce n’est pas pour autant que l’on peut profiter de cette violence du chômage en exploitant cette main d’oeuvre comme au XIXe siècle.
À partir de ce constat, je défends une intervention de l’État qui doit permettre aux personnes de se protéger avec un cadre légal et de s’organiser. Il faut aussi travailler sur le statut d’entrepreneur, je comprends l’ambition de flexibilité, mais le statut d’auto-entrepreneur est mauvais et complexe. Enfin, si vous tirez l’essentiel de vos revenus de cette activité, vous devez être employé par Uber : c’est un objectif politique que je défends.
L’ampleur nationale de votre mandat potentiel reste importante pour vous ?
Oui, bien sûr, je le dis aux électeurs : votez pour moi car je suis le seul candidat qui aura une ampleur nationale, je compte bien peser sur les arbitrages, au niveau local comme national. Toutefois, je suis par exemple pour la suppression de la réserve parlementaire : si je suis élu je ne l’utiliserai pas car je considère que c’est une pratique clientéliste.
Au niveau local, je ne peux pas tout faire : je veux être député, pas maire ou conseiller départemental. Je sais que les autres candidats essaient de jouer à celui qui est le plus proche du terrain […] : nous, nous sommes là pour défendre un programme national, défendre des lois. Je ne vais pas aider une association de quartier par exemple, ce n’est pas mon rôle.
Existe-t-il aujourd’hui une initiative spécifique dans la tech qui vous paraît prometteuse ?
Je pense qu’il y a un choix que nous devons faire et c’est tout simplement collectiviser l’algorithme de Google. Il faut se fixer cette ambition forte, quitte à ce que je fasse peur à tous les anti-communistes. C’est un enjeu fondamental, nous ne devons pas avoir peur de mener cette lutte. C’est une entreprise qui a eu un coup de chance, en arrivant au moment où ses concurrents s’effondraient, et qui tire de cette situation une richesse complètement délirante depuis des années. Google ne sait plus quoi faire de cette richesse. Même d’un point de vue libéral, Google semble trop riche pour optimiser l’utilisation de son argent qui dort.
Enfin, collectiviser cet algorithme c’est rendre au public la capacité de compréhension des mécanismes de l’information, car la situation monopolistique de Google pose également problème pour l’accès libre à l’information. L’argent récupéré par l’État en s’attaquant à ces groupes devrait être utilisé pour recréer une presse française indépendante, comme lors de l’après-guerre. Nous pouvons aussi penser à imposer des règles à ces entreprises sur la classification de l’information, afin d’empêcher que des intêréts privés puissent filtrer notre information.
nous devons tout simplement collectiviser l’algorithme de Google
Vous pensez aux fake news ?
Nous avons beaucoup parlé des fake news mais c’est un effet naturel du système que l’on a créé : nous avons mis notre accès à l’information entre les mains d’entreprises privées dont le seul but est de tirer du profit. Nous l’avons fait de façon inconsciente : il faut que l’on pose désormais des questions sur les modèles économiques des plateformes comme Facebook et Google.
Sur Facebook en particulier, il faut bien comprendre que le réseau ne s’intéresse pas aux news qu’il distribue. Pour lui, qu’il s’agisse d’une fake news ou non, ça n’a pas d’importance, il vous a proposé l’article pour faire de l’argent avant toute chose. Il y a donc un problème démocratique dans une société où ces plateformes deviennent notre principal accès à l’information.
En ce sens, le problème des fake news n’est pas un problème politicien. Que des forces politiques produisent des fake news pour influencer des votes, c’est de la surface. Le vrai problème, ce sont les entreprises privés qui dominent notre espace public et l’information.
Ne dédouanez-vous pas un peu vite les créateurs de fake news, qui ont quand même une part de responsabilité dans ce mélange des genres dans l’information ?
Des acteurs opportunistes, des acteurs malveillants, des forces étrangères qui tentent de saboter notre système démocratique, il y en aura toujours. Mais la question me semble systémique : pourquoi laissons-nous des failles béantes dans notre système, dans lesquelles il est si simple de s’immiscer ?
Que la Russie — demain, on peut aussi imaginer la Chine ou la Corée du Nord — tentent de nous déstabiliser, ça arrivera. On doit idéologiquement lutter contre mais ce sont des acteurs prêts à tout. La réponse vient donc du système dont ceux-ci profitent. Il faut réfléchir à la situation telle que nous la connaissons : la Russie qui peut déstabiliser en France une élection avec les Macron Leaks — et ne pas y arriver en l’occurrence –, ça doit questionner sur la rupture technologique en cours.
Justement, au lendemain des Macron Leaks, vous vous interrogez sur Twitter quant au timing choisi pour les révélations. WikiLeaks décide de son côté de partager ces données. Comprenez-vous la méfiance qui grandit à l’égard de l’organisation ?
Je ne suis plus payé par WikiLeaks depuis un an, j’ai donc ma liberté de parole pour donner mon avis sur l’organisation : je veux que ce soit clair. J’ai trouvé que [la publication des Macron Leaks à deux jours du deuxième tour] était une manipulation tellement grossière que c’était un cri du cœur pour moi. Je ne pouvais que me détacher de cette initiative.
En tant qu’avocat de l’organisation, je n’en suis pas un porte-parole. Toutefois, je peux — en connaissance — parler de ce qu’il se passe à l’intérieur de WikiLeaks. On parle d’une poignée de personnes qui naviguent entre les grands États, sans jamais être protégés par aucun. Il s’agit donc de personnes sans aucune protection institutionnelle qui se lancent sur le terrain des deep state et s’attaquent à des organisations qui agissent en dehors de toute légalité [les services secrets].
Il faut s’imaginer la violence que ça implique de jouer à l’espion au milieu de ces géants lorsque l’on est WikiLeaks. Prenez un espion : quoiqu’il lui arrive, il aura toujours une protection derrière lui, la possibilité d’être extrait de sa couverture et d’être protégé. Quand Julian Assange joue à l’espion et détient des informations secrètes, il n’a rien pour se protéger et joue sa vie. WikiLeaks est une organisation extrêmement vulnérable.
Maintenant, les États-Unis ont voulu détruire WikiLeaks, c’est très clair. Mais plutôt que s’attaquer à lui, ce qui aurait pu être le cas s’il n’avait pas publié les documents et n’avait pas reçu l’aide du New York Times, il a fallu décrédibiliser l’institution en devenir. À ce moment là, à pic — et ce n’est pas un complot — tombe une affaire très dérangeante [une accusation de viol], Julian Assange est dans le feu de l’action et il se retrouve du jour au lendemain isolé et décrédibilisé. Il s’enferme dans une ambassade, mais résiste.
Néanmoins, en isolant Assange, en attaquant les systèmes qui font WikiLeaks : on se retrouve avec une des organisations les plus suivies au monde qui est complètement affaiblie, vulnérable et isolée, tout en portant une responsabilité énorme. Nous avons pris le risque que des agents d’influence nouveaux puissent infiltrer l’organisation ou manipuler cette organisation.
les États-Unis ont voulu détruire WikiLeaks
Aujourd’hui, pour être bref, je ne pense pas qu’Assange a perdu ses idéaux et est devenu un horrible personnage. Je pense qu’il faut essayer de se mettre à sa place, comprendre la difficulté des choix qu’il fait et mesurer la part de responsabilité que nous avons dans son isolement.
Allez-vous poursuivre votre engagement auprès WikiLeaks si vous êtes élu ?
Non, bien sûr que non. J’ai passé trois ans sur l’affaire suédoise pour parvenir au résultat qui est désormais connu. Mon rôle dans l’organisation est aujourd’hui limité.
Si je suis élu, la question des conflits d’intérêts est fondamentale : je ne peux pas être lié à une quelconque organisation dont je n’ai pas le contrôle, même si je me battrai pour qu’Assange soit accueilli en France. Mais ça c’est un combat politique.
Propos recueillis par Alexis Orsini et Corentin Durand
Photographies par Jean-Baptiste Martin
+ rapide, + pratique, + exclusif
Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.
Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.
Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci
Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.
C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.
Mais si vous le pouvez,
voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :
- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.
- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.
- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.
Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil
Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !