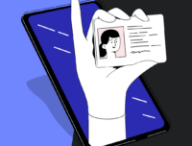Pourquoi les femmes ont-elles disparu de la tech ? Où sont passées les inventrices en informatique, astronomie ou chimie, dont le travail a été éclipsé par des hommes ? Depuis une quinzaine d’années, Isabelle Collet, professeure associée en sciences de l’éducation à l’université de Genève et spécialiste de l’inclusion des femmes dans le numérique, s’intéresse à ces questions.
Dans son nouvel ouvrage, Les oubliées du numérique, la chercheuse propose un résumé accessible de ces années de recherche. Numerama l’a rencontrée.
Vous écrivez que « c’est dans la tech qu’on touche du doigt les limites des discours qui vantent l’avancée inexorable de l’égalité femmes/hommes » : quelle est la particularité du numérique dans ce domaine ?
Isabelle Collet : Avec le numérique, on peut mettre en évidence le fait que l’égalité ne se produit pas par elle-même. Il n’y a pas une naturalité du progrès qui permettrait d’aller vers l’égalité dans tous les domaines. Néanmoins, il y a des spécificités dans le numérique : d’abord, l’impressionnante montée en prestige des métiers et des activités en lien avec l’informatique. Ces métiers n’existaient pas puis, soudain, ils sont devenus absolument stratégiques.
Dans les années 1970 et 1980 en France, il y avait un discours intéressant qui disait que puisqu’il n’y avait pas de corporation ouvrière derrière l’informatique, la tradition d’exclusion des femmes ne devrait pas s’y poursuivre. Les femmes arrivaient sur le marché de l’emploi à ce moment-là, en toute logique on devait donc atteindre la parité. Le numérique a ensuite pris de l’ampleur, les filières d’études se sont élargies de plus en plus. Ces nouvelles places ont d’abord été occupées par des hommes.
Le deuxième phénomène, qui s’est produit en même temps, est l’arrivée du micro-ordinateur. Les garçons ont été équipés les premiers, comme à chaque fois qu’un nouvel objet technologique arrive, car on imagine toujours un lien naturel et spontané entre les garçons et la science. Voilà ce qui a créé une représentation factice du monde de l’informatique, autour de la figure du geek que l’on connaît aujourd’hui.
Peut-on vraiment dire que les femmes se détournent ou se désintéressent de l’informatique ?
Quand on regarde les chiffres, on s’aperçoit que pendant longtemps les femmes ne s’en étaient pas détournées. Certes, elles n’étaient pas nombreuses ; énormément de places ont été occupées par des hommes. Évidemment, traduite en pourcentage, la part des femmes s’effondre. Avec la montée en prestige du métier et le rôle joué par le micro-ordinateur, les hommes sont arrivés en masse.
On évoque souvent l’idée que les femmes s’autocensureraient : faut-il remettre en question cette affirmation ?
Je conçois que cela peut paraître contre-intuitif : il y a effectivement des femmes dont les propos témoignent d’un évitement ou dont les stratégies peuvent s’apparenter à de l’auto-exclusion. Il faut se demander pourquoi elles se détournent et d’où vient ce manque de confiance en elles. Il n’y a rien de naturel là-dedans. Tout au long de leur vie, depuis les premières expériences de jouets jusqu’à l’enseignement supérieur, un ensemble de messages s’adresse aux femmes pour leur dire qu’elles ne sont pas à leur place. Au bout d’un moment, à force d’entendre ça, les femmes ont des doutes.
Quand bien même elles n’auraient pas de doutes sur leurs compétences, elles constatent aussi l’hostilité de ce milieu et peuvent s’interroger : dois-je vraiment me fatiguer à me faire une place, ou mes compétences ne seraient-elles pas mieux reconnues dans d’autres domaines ? Ce n’est pas de l’auto-exclusion, c’est une censure sociale qui les a poussées dehors. Si on pense que c’est de l’auto-exclusion, on va chercher à renforcer les femmes. Bien sûr qu’il faut le faire, mais cela reste une mesure à court-terme. Il serait bien plus durable d’arrêter ces processus d’auto-exclusion pour que les femmes se sentent, dès le départ, à leur place.
Les « bonnes pratiques » pour inclure les femmes dans la tech se valent-elles ? Est-ce illusoire de « peindre la tech en rose », comme vous l’écrivez dans votre ouvrage ?
Peindre la tech en rose, c’est contre-productif. On rappelle ainsi aux femmes tous les stéréotypes qui les excluent, tout en créant une tech rien que pour elles. La tech est habillée de manière girly et attractive. Cette « tech pour fille » est présentée comme plus spécifique. Par conséquent, la tech avec un grand « T » devient la tech pour garçon. Cette mesure peut avoir du succès : si on met des licornes et des chatons partout, cela peut attirer du monde. Mais les mesures incitatives ne doivent pas être évaluées à l’applaudimètre. Elles doivent être mesurées à l’aune de leur efficacité.
D’autres mesures, qui ont aussi leurs limites, sont celles de l’empowerment : donner des modèles, renforcer les femmes, des prix réservés aux femmes… Tout cela est utile. Mais si on levait les obstacles, on n’aurait plus besoin du renforcement. Quand une institution fait avant tout la promotion de ces mesures, il y a un côté malhonnête. Cela revient à dire aux femmes : si vous faites mieux que les hommes, vous aurez autant. Ce n’est ni vendeur, ni juste.
L’instauration de quotas est-elle une solution pour s’attaquer au cœur du problème ?
Même si ce n’est pas la mesure la plus satisfaisante intellectuellement, l’instauration des quotas a deux avantages : elle est rapide et peu coûteuse. Il existe des mesures bien plus intéressantes sur le plan intellectuel, avec un pouvoir de transformation bien plus profond et bien plus subtil, mais elles demandent un coût et une réflexion. Pour qu’elles soient rapides, il faut des moyens. À force d’échouer avec d’autres mesures, de plus en plus d’organisations se tournent vers les quotas. Cette solution suscite une angoisse : si on a un quota, on risquerait de baisser le niveau. Mais ce n’est pas le cas.
Dans votre livre, vous prenez l’exemple de la Malaisie : les métiers de l’informatique y sont perçus comme féminins, car ils permettent de travailler en restant chez soi et ne sont pas fatigants physiquement. Cette vision peut sembler encourageante, mais n’est-elle pas encore le résultat d’une norme de genre ?
Effectivement, mauvaise nouvelle : le système de genre est à l’œuvre partout. Néanmoins, cet exemple prouve qu’il n’y a rien de naturel ou d’inné. Il montre aussi la force des discours sociaux. Ce cas souligne aussi le fait qu’une profession peut exiger des compétences extrêmement variées. L’informatique est un travail dans lequel il n’est pas nécessaire de porter de lourdes charges. On a tendance à se focaliser sur une seule compétence, qui est genrée. En Occident, la dimension technique est genrée au masculin. En Malaisie, le fait que le métier permette le télétravail, qu’il puisse être exercé seule et qu’il ne soit pas dangereux est associé au féminin.
Les valeurs associées à la masculinité (force, résistance physique) peuvent sembler peu utiles pour se servir d’un ordinateur. Alors pourquoi écrivez-vous que « les savoirs du numérique font partie de la masculinité hégémonique » ?
La masculinité hégémonique, c’est-à-dire la justification du patriarcat, se fabrique au besoin. Elle regroupe les composants qui justifient le fait d’avoir un pouvoir sur les femmes et les hommes que l’on juge moins virils. D’ailleurs, cette masculinité hégémonique ne s’exprime pas de la même manière dans les classes socioculturelles supérieures et dans les classes ouvrières. Actuellement, les composantes fortes de cette masculinité hégémonique sont de gagner de l’argent, d’avoir un pouvoir sur les objets et la technique, de ne pas être guidé par ses émotions. Le qualificatif de la force physique est devenu moins important.
La résistance reste une valeur en informatique. Il y a une culture qui prône le fait de coder toute la nuit, de faire des hackatons. La puissance sexuelle, soit la capacité à coucher avec toutes les femmes, est aussi présente : elle est sublimée dans le jeu vidéo, où l’on peut incarner un personnage. Il ne faut pas pour autant oublier qu’au sein de l’informatique, beaucoup d’hommes rejettent les diktats de la masculinité.
Vous écrivez que l’ordinateur peut servir aux hommes à réaliser finalement un fantasme, celui de l’auto-engendrement. Quel est ce fantasme d’un monde sans femmes ?
Pour le rendre visible, il faut remonter à la création des premiers ordinateurs. La personnalité la plus emblématique de ce phénomène est le mathématicien John von Neuman. Pour lui, l’aboutissement ultime de la science, c’est de dupliquer le cerveau humain. Il ne s’agit pas de n’importe quel cerveau : c’est le sien. Dans son article sur le jeu de l’imitation, Alan Turing définit une machine qui représente symboliquement l’enfant des ingénieurs qui le créent. L’apprentissage s’installe dans un mode père-fils. Il y a une scène exceptionnelle dans 2010: L’année du premier contact [ndlr : la suite de 2001: L’Odyssée de l’espace]. Le Docteur Chandra, l’informaticien qui a créé Hal, l’ordinateur qui massacre tout le monde dans la station spatiale, se considère comme son père. L’ordinateur Hal est lui-même présenté comme le fil de Chandra.
Il reste cette volonté, non pas de de dupliquer, mais de créer des êtres quasi vivants, de simuler la vie au sein de l’ordinateur, de créer des mondes. Ce sont des façons symboliques de s’engendrer sans avoir besoin de personne. C’est un monde sans femmes, qui fait de la création dans des univers virtuels. Comme on se moque du support physique de cette intelligence, il n’y a plus de corps. On n’a plus besoin de la reproduction sexuée et on peut faire de la reproduction virtuelle dans les machines. Ce fantasme peut tout à fait être partagé par les femmes. Cependant, la société explique que les femmes peuvent créer physiquement et les hommes, s’ils veulent créer, doivent le faire symboliquement. Les femmes n’en auraient, soi-disant, pas besoin.
Propos recueillis par Nelly Lesage
Cet article contient un lien affilié : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.
+ rapide, + pratique, + exclusif
Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.
Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.
Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci
Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.
C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.
Mais si vous le pouvez,
voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :
- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.
- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.
- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.
Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil
Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !