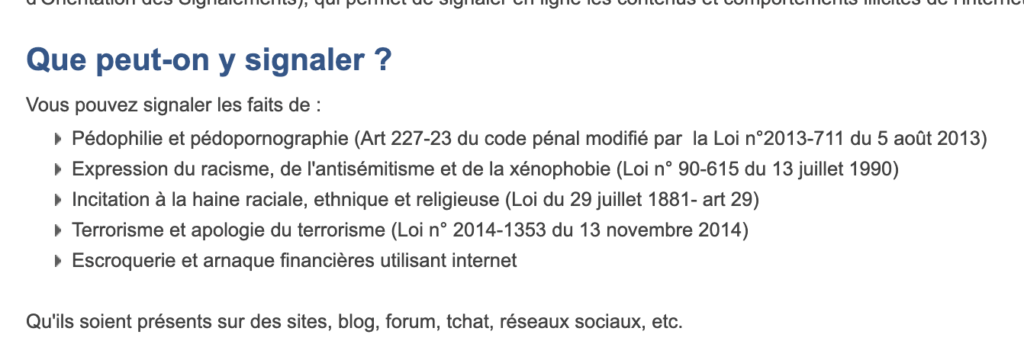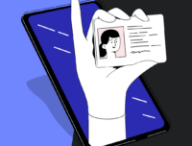« Il est temps d’arrêter de nous bassiner avec l’anonymat en ligne », écrivait-on sur Numerama en juillet 2020. Cet été, le Premier ministre Jean Castex s’était laissé aller à un vif réquisitoire contre les réseaux sociaux, qu’il comparait sans nuance au « régime de Vichy » : « On peut vous traiter de tous les noms, de tous les vices, en se cachant derrière des pseudonymes. » C’est faux, bien sûr. Mais à chaque événement qui marque l’actualité, ce discours revient.
L’anonymat en ligne n’est toujours pas le problème
L’assassinat, ce 16 octobre, de Samuel Paty, un enseignant d’histoire-géographie qui avait montré à ses élèves une caricature de Mahomet au cours d’une leçon sur la liberté d’expression, a poussé plusieurs personnalités politiques et médiatiques à relancer ce débat sur l’anonymat en ligne. Interrogé sur cet acte terroriste d’une barbarie infâme, Xavier Bertrand, président du conseil régional des Hauts-de-France et candidat à la présidentielle de 2022, a ainsi indiqué sur RTL : « Il faut que l’anonymat pour ceux qui font l’apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux soit levé beaucoup plus vite (…) Vous ouvrez un compte, vous donnez votre identité juste à l’hébergeur. S’il y a des menaces et l’apologie du terrorisme, on ne va pas mettre tant de temps que ça à fermer le compte, à condamner et poursuivre. Les réseaux sociaux sont un lieu d’impunité.»
Le premier fait à noter est que, contrairement à ce que sous-entend le titre de l’article en ligne qui reprend ses propos, Xavier Bertrand ne demande pas de facto « la fin de l’anonymat sur internet » : il propose que chacun doive décliner son identité réelle aux plateformes pour pouvoir être identifié plus rapidement en cas de propos délictuels ou criminels. Sa proposition reste toutefois mal informée, car, comme nous le rappelons régulièrement, l’anonymat en ligne n’existe pas.
Depuis 2004 en France, la loi pour la confiance dans l’économie numérique, et son article 6 en particulier, permet l’identification des internautes qui publient des contenus illégaux en ligne. En l’espèce, une ou un internaute n’est quasiment jamais anonyme sur le web, que ce soit parce que :
- son fournisseur d’accès à internet dispose d’informations sur lui ;
- son adresse IP lui donne une sorte de « signature en ligne » qui permet souvent de l’identifier (certains moyens, comme l’utilisation de VPN, peuvent compliquer cette identification) ;
- les réseaux sociaux demandent eux-mêmes de plus en plus souvent des gages d’identité « réelle», que ce soit pour la mise en place d’une double authentification (déjà en place sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) ou pour valider la création de comptes (Twitter demande par exemple régulièrement cet identifiant, parfois même de manière obligatoire pour récupérer un compte).
Donner plus de moyens à la justice d’agir : l’exemple de Pharos
Pour comprendre pourquoi mettre fin à un prétendu anonymat en ligne n’est pas la solution, il faut plutôt s’intéresser aux problèmes que soulèvent les événements tragiques de ce mois d’octobre. Le premier concerne la plateforme de signalement Pharos, et Twitter.
Comme l’a rapidement révélé Médiapart, le terroriste qui a assassiné Samuel Paty avait affiché des signes de radicalisation sur Twitter, et avait même été signalé en juillet pour « apologie de la violence, incitation à la haine, homophobie et racisme » sur Pharos, la plateforme créée en 2009 où les internautes peuvent signaler des contenus illicites observés en ligne. Les propos liés à du « terrorisme et apologie du terrorisme » font partie des contenus qui peuvent être signalés, qu’ils soient « présents sur des sites, blog, forum, tchat, réseaux sociaux, etc », décrit le site officiel. Le compte de l’assassin terroriste de Samuel Paty aurait « fait l’objet de plusieurs signalements Pharos ces derniers mois », selon les informations de Médiapart, qui mentionne également le fait qu’en août dernier, il avait publié un photomontage d’un homme décapité (qui n’a pas pu être identifié) sur son compte personnel — le même qui lui a servi à publier une photo sordide de la tête de l’enseignant qu’il avait décapité.
La question qui se pose coule de source : que sont devenus ces signalements ? S’agit-il d’une question d’anonymat, ou un d’une question de moyens humains, financiers et juridiques ?
La plateforme Pharos a reçu 163 000 signalements en 2018 et 228 000 signalements en 2019, dont « entre 4 500 et 6 500 contenus terroristes » cette année-là. En mai 2020, il y avait 28 « policiers et gendarmes, spécialistes de la cybercriminalité » chargés du recueil des signalements, apprend-on dans une réponse parlementaire relevée par NextInpact. Ils étaient 25 en 2018, alors que le nombre de contenus signalés était beaucoup moins élevé qu’aujourd’hui.
Ces chiffres montrent bien le décalage entre la quantité de contenus à vérifier, et le nombre de personnes chargées de le faire. La question des moyens mis à la disposition de la justice se pose également : aujourd’hui, celle-ci n’a aucune manière d’agir pour réguler la haine en ligne — en 2017, le gouvernement allouait, pour 1 000 euros d’argent public dépensés, la modique comme de 4 euros à la justice, soit 0,4 %, alors qu’il s’agit d’une mission régalienne.
Or une information récente a montré qu’un changement était possible : en réaction à l’actualité, le ministère de l’Intérieur a communiqué très largement, le dimanche 18 octobre, sur le fait qu’il avait identifié « 80 messages qui soutiennent l’action de l’agresseur de Samuel Paty » signalés sur la plateforme Pharos et que « des procédures seront diligentées contre les personnes qui les ont diffusés ». Le constat est amer, car il sous-entend que la justice a, sur le papier, la possibilité d’agir, si on lui en donne la priorité.
La vidéo de « dénonciation » aurait-elle pu disparaître de Facebook ?
Descendons à présent encore d’un niveau pour atteindre l’un des problèmes les plus épineux, en termes de liberté sur le web, de l’histoire de l’assassinat terroriste de Samuel Paty.
L’enseignant a été ciblé car il était pris à partie, depuis plusieurs jours, par des vidéos diffusées publiquement par un parent d’élève sur Facebook, et reprises sur YouTube. Il y traitait Samuel Paty de « voyou », assurant que le professeur de sa fille avait demandé à des élèves musulmans de quitter sa salle de classe, mentionnant sa « chérie de 13 ans qui a été harcelée plusieurs fois par son professeur d’histoire » — le détail des dates de publication des différentes vidéos a été finement retracé par une enquête du Monde. Il y appelait à la mobilisation contre l’enseignant, soutenu par Abdelhakim Sefrioui, militant islamiste, qui a lui aussi participé à au moins une vidéo, le 12 octobre, exigeant la suspension du professeur qu’il appelait aussi « voyou ».
Ces vidéos sont devenues, comme on le dit dans le jargon anglicisé d’internet, « virales » : elles ont été à la fois partagées sur Facebook par des particuliers, mais aussi en groupes plus restreints comme sur Snapchat ou WhatsApp. L’une des vidéos a été partagée par la mosquée de Pantin, qui compte 96 000 abonnés (et 64 000 « likes ») sur Facebook, ce qui a contribué à toucher un plus grand nombre d’internautes encore. Dans les commentaires de cette publication de la mosquée de Pantin, au moins un internaute a diffusé le nom de Samuel Paty et l’adresse de son école, comme l’a relevé FranceInfo. Le média a également interrogé, le 19 octobre, le recteur de la mosquée, qui a indiqué « regretter » ce partage : « A posteriori, vu ce qu’il s’est passé on regrette de l’avoir publiée. On est en train de voir comment à l’avenir prendre un peu de recul avant de s’emballer sur des choses comme ça. »
Lorsque l’on connaît la gravité des événements qui ont découlé de cette viralité, ces regrets peuvent paraître minces. Ils permettent cependant de mettre le doigt sur un des points les plus complexes de cette affaire : les publications du parent d’élève auraient-elles pu être supprimées, en l’état actuel du droit français ? Sont-elles, à proprement parler, illégales ? Les réseaux sociaux comme Facebook avaient-ils l’obligation de les faire disparaître ? Peut-on aller au-delà de la responsabilisation individuelle et d’une prise de conscience des conséquences de la rapidité et la frénésie qu’entraînent les boutons de partage sur Internet (le « share », le retweet, le reblog) ?
La loi Avia revient sur le devant de la scène
Est-il aujourd’hui possible d’inscrire réellement des barrières efficaces dans le droit, qui ne risqueraient pas d’empiéter directement sur les libertés individuelles, et d’être néfastes pour les citoyens ? Ces dérives potentielles sont au cœur de ce qu’il a été reproché à la loi Avia, fracassée par le Conseil constitutionnel en juin 2020, notamment parce qu’elle contraignait les plateformes à retirer en 24 heures, après leur signalement, des contenus manifestement illicites, sans contrôle d’un juge et que la haute juridiction estimait que des « risques de censure » étaient bien réels.
Changer les plateformes, mais aussi changer les gens
C’est là que les questions se bousculent, et que les personnalités médiatiques se manifestent beaucoup moins pour faire émerger des solutions toutes faites. Lorsqu’il est impossible d’accuser « l’anonymat en ligne », puisque c’est une personne qui a publié une vidéo sous son vrai nom, en donnant son propre numéro de téléphone, et dont les publications ont été partagées par une entité religieuse identifiée. Impossible, donc, d’accuser l’anonymat en ligne alors même que la désanonymisation de l’enseignant — son nom a été publié ainsi que celui de son école — a probablement grandement facilité son identification et sa localisation (Samuel Paty avait d’ailleurs porté plainte en diffamation contre le parent d’élève).
Les réseaux sociaux n’ont pas causé cet emballement, ce sont les êtres humains qui ont utilisé ces outils et partagé ces messages. Les fils d’actualité Facebook ont sûrement joué un rôle dans la propagation de ces vidéos, tout comme les partages sur les messageries privées, dans des petits groupes, des contenus qui s’envoient, se regardent et se renvoient à d’autres, générant des ramifications exponentielles.
La frénésie est récompensée sur les réseaux sociaux
Cependant, fermer les yeux sur le fait que le fonctionnement-même de certaines plateformes encourage une viralité frénétique serait une erreur. Même les GAFA le savent : Twitter commence ainsi à tester une option qui demande à ses utilisateurs de bien réfléchir avant de retweeter un message. « Il faut casser ce qu’on appelle les chaînes de contagion de ces réseaux », exprime Dominique Boullier, spécialiste du numérique, cité dans un excellent billet de blog du chercheur Olivier Ertzscheid sur affordance.com. « Les utilisateurs vont s’exprimer radicalement, dire des bêtises, il y aura des fake news, des propos de haine, on est bien d’accord, mais simplement il ne faut pas que ça se propage à la vitesse à laquelle ça se propage (…) Il faut arrêter les réflexes, les réactions instantanées par retweet ou partage, like, etc. »
C’est là où les plateformes pourraient être modifiées durablement et de manière intelligente et raisonnée ; en s’attaquant à leurs mécanismes, afin de lutter en amont et pas uniquement en réaction. Et pourquoi pas, s’il faut y passer, y ajouter des nouveaux systèmes malicieux, qui viendraient récompenser, sous une forme qui reste à inventer, celles et ceux qui prennent le temps de lire, d’écouter, de ralentir.
À ces changements, il conviendrait bien sûr d’ajouter de la pédagogie et de l’éducation, dès le plus jeune âge, sur la responsabilité qui incombe à chacun dans son comportement en ligne, au même titre que ce que l’on enseigne déjà pour la vie hors ligne. Cette alliance permettrait de transcender le discours trop simpliste des « méchants réseaux sociaux » et, à défaut d’en tirer le meilleur, d’en éviter surtout le pire.
+ rapide, + pratique, + exclusif
Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.
Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.
Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci
Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.
C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.
Mais si vous le pouvez,
voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :
- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.
- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.
- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.
Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil
Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !