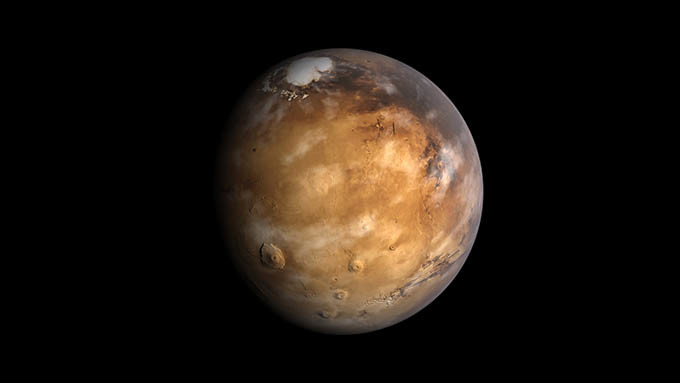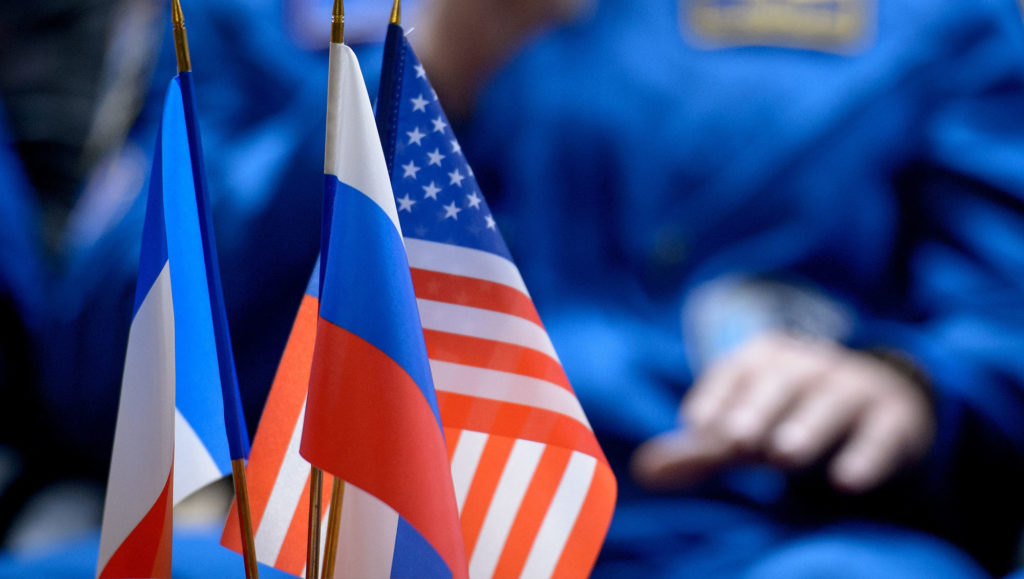De novembre 2016 à juin 2017, le spationaute français Thomas Pesquet a eu la chance de passer six mois à bord de la station spatiale internationale (ISS). Cette aventure spatiale a permis de relancer l’intérêt du public pour cette superstructure qui orbite autour de la Terre à une orbite d’environ 400 kilomètres d’altitude. Mais ce programme ambitieux n’est pas forcément bien connu.
Aussi, afin d’apporter quelques réponses aux questions que vous vous posez peut-être, en particulier sur l’application du droit à bord, qu’il s’agisse d’une infraction, de la question de la résolution d’un dommage ou de certains actes de la vie civile, nous nous sommes entretenus avec Julien Mariez, le chef du service juridique au Centre national d’études spatiales (Cnes), qui est l’agence spatiale de la France.
Quel est le cadre juridique de la station spatiale internationale ?
Quinze États ont signé le traité, dont onze nations européennes : l’Allemagne, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la France, l’Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Russie, la Suède et la Suisse.
Il existe un traité international qui a été signé le 29 janvier 1998 entre les États qui participent à la station spatiale internationale (ISS). Cet accord, de très haut niveau, définit un cadre de coopération et détermine les droits et les obligations des partenaires au regard de la conception des modules, de l’utilisation des installations de l’ISS ainsi que des modalités de gestion de la station.
Dans cet accord, un principe particulier est posé : les États-Unis sont le « chef de file » de cette coopération internationale, ce qui veut dire qu’ils ont une sorte de rôle-cadre pour coordonner globalement les activités relatives à l’ISS. Ce rôle de leader concerne notamment l’ingénierie et l’intégration d’ensemble du système, la gestion et l’organisation du programme et ainsi les impératifs et les plans en matière de sécurité.
Comment s’articule la coopération européenne dans ce contexte ?
Les États du Vieux Continent qui participent à l’ISS le font à travers l’Agence spatiale européenne (ESA), qui est l’organisation internationale mise en place par les pays européens pour s’occuper du spatial, et non pas à travers l’Union européenne. L’ESA est une structure indépendante de l’Union : il s’agit d’un projet intergouvernemental, qui compte aujourd’hui 22 membres.
D’ailleurs, il faut noter que parmi les États européens qui sont membres de l’ESA et qui ont signé le traité sur l’ISS, il y a la Suisse et la Norvège, qui se trouvent en dehors de l’Union. Il faut donc bien distinguer l’Union européenne et l’ESA : ce sont deux organisations distinctes, qui n’ont pas les mêmes membres. Dans ce cadre, les spationautes français comme Thomas Pesquet sont salariés de l’ESA.
Que trouve-t-on dans ce traité ?
L’accord va poser des conditions concrètes d’exploitation de la station mais aussi un cadre pour traiter les principales problématiques juridiques, que ce soit en matière de responsabilité, en matière de propriété intellectuelle ou en matière de juridiction pénale.
Il fixe aussi les conditions d’utilisation : le principe général est que chaque participant est censé contribuer à la station, en fournissant des modules, des équipements ou, à défaut, des moyens financiers pour participer aux frais communs d’exploitation, en fonction de l’utilisation effective de la station faite par chacun.. C’est un peu comme un immeuble : quand vous êtes propriétaire, vous partagez les frais de copropriété.
Un principe important qui est posé dans le traité, c’est la dimension évolutive de l’ISS. Au fil des ans,la station s’est vu adjoindre des modules supplémentaires. C’était le cas en 2008 avec le laboratoire européen Columbus et le module logistique japonais Kibō et ça le sera encore d’ici 2019, avec le laboratoire russe Nauka et un bras télémanipulateur européen.
Les dispositions prévues par l’accord sur l’ISS s’appliquent-elles pour d’autres futures stations ou bases spatiales ?
Aujourd’hui, cet accord est uniquement applicable à la station spatiale internationale. Si jamais les États veulent construire une autre structure de ce type, en orbite autour de la Terre ou de n’importe quel autre corps céleste, ou s’il s’agit de bâtir une base sur la Lune ou même sur Mars, il faudrait conclure un nouvel accord entre les nations concernées.
Ce qui est important de souligner, c’est qu’en dehors de cet accord spécifique, propre à l’ISS, il existe en droit international plusieurs traités relatifs à l’espace. Il y en a cinq principaux, dont le premier a été conclu en 1967, avant même que l’homme se rende sur la Lune.
Ces textes posent les grands principes de l’utilisation et de l’exploration de l’espace. Parmi ces dispositions figure le principe de non-appropriation des corps célestes. Aucun État, aucun ressortissant ne peut s’approprier un corps céleste, quel qu’il soit, que ce soit une planète, un satellite ou même un astéroïde. Les projets de colonisation du système solaire, chers à Elon Musk par exemple, devront se faire dans le respect du droit international.
À quel territoire appartient l’ISS ?
Les modules installés sur l’ISS sont d’une certaine façon des prolongements des territoires des États concernés. Quand vous êtes à bord d’un module américain, immatriculé par les États-Unis, vous êtes soumis au droit américain. C’est la même chose pour les modules japonais ou russes.
Chaque État est censé immatriculer le module ou les modules qu’il apporte à la station. C’est une obligation issue d’un autre traité, sur l’espace, qui prévoit que les États doivent immatriculer leurs objets spatiaux, en les inscrivant sur un registre national avant de faire suivre les informations à l’Organisation des Nations unies (ONU). Vous avez donc une sorte de registre international tenu par le Bureau des affaires spatiales à l’ONU qui recense tous les objets spatiaux actuellement dans l’espace, du moins ceux effectivement déclarés par les États.
Et dans le cas d’un module européen ?
Effectivement, il existe une petite complexité pour la partie européenne puisque l’on a affaire à plusieurs États qui se sont en quelque sorte associés. En l’espèce, ces pays ont désigné l’ESA comme leur agence de mise en œuvre. Ainsi, même si des pays comme la France, l’Italie ou l’Allemagne sont partis à l’accord, ils ont désigné l’ESA comme étant l’organisme en charge d’appliquer l’accord pour leur compte. De ce fait, c’est l’ESA qui est en charge de l’immatriculation des modules européens. C’est le cas par exemple du module Columbus.
Si c’est le droit des pays qui ont immatriculé les modules qui s’applique à bord, quid des ajouts européens, car il existe peut-être des différences juridiques même si les lois européennes sont plutôt homogènes ?
Le principe est en effet que chacun des droits nationaux des États européens peut s’appliquer au sein des modules européens. On pourrait en théorie imaginer l’existence de contradictions juridiques entre deux États membres, même s’il faut relever que les législations entre les pays du Vieux Continent sont assez homogènes. En la matière, l’accord sur l’ISS résout ce cas de figure de façon pragmatique, en traitant l’articulation entre législations nationales pour les problèmes juridiques les plus susceptibles de se produire à bord de la station.
Quels sont ces problèmes concrets qu’anticipe le traité ?
Le premier porte sur la propriété intellectuelle. Il y a des expériences scientifiques qui se font à bord de l’ISS, donc on peut envisager la survenue d’innovations, de découvertes ou d’inventions. Celles-ci pourraient nécessiter d’être brevetées, donc d’être protégées au titre de la propriété intellectuelle.
Le deuxième enjeu, c’est le droit pénal : qu’est-ce qu’il se passe en cas d’infraction commise par un astronaute ?
Et le troisième problème, c’est la responsabilité entre États en cas de dommages. Parce qu’au-delà de l’aspect pénal, comme un astronaute qui volontairement va poignarder son petit camarade, il peut aussi arriver lors des activités que du matériau soit endommagé ou qu’un astronaute soit blessé fortuitement par un instrument, par un autre astronaute.
L’accord prévoit ainsi un régime de responsabilité entre États participants,basé sur une renonciation à recours entre États.
Un nouvel État comme le Brésil, la Chine ou l’Inde peut-il accéder au traité ?
L’accord ne prévoit pas l’accession d’un nouveau membre et il n’y a pas eu, à ma connaissance, de demande en ce sens depuis 1998. Les Chinois, par exemple, poursuivent pour l’instant un projet de leur côté, avec un embryon de station, qui est d’ailleurs en proche de retomber sur Terre et qui devrait être remplacée par une nouvelle installation dans quelque temps.
Même si rien n’est prévu sur le papier, rien n’empêche les participants de se mettre d’accord, le cas échéant, pour admettre un nouveau membre. Dans ce cas-là, il faudra évidemment recueillir un consentement unanime des États participants et modifier l’accord existant en ce sens. L’accession d’un nouveau membre est toutefois très peu probable.
Il est en revanche expressément prévu dans le traité qu’un État puisse se retirer de la coopération.
Et quid de l’arrivée éventuelle de modules privés, type SpaceX ?
L’accord ne prévoit pas l’implication dune entreprise privée. Aujourd’hui, c’est réellement une coopération entre États, dans le cadre d’une coopération de nature publique.
L’hypothèse d’une cession totale ou partielle de l’ISS au secteur privé est parfois évoquée, parce que le projet représente un coût important pour les États, notamment les USA, mais aussi la France. Et dans la mesure où il n’est pas prévu d’exploiter ad vitam æternam cette station, il arrivera un jour où les nations décideront conjointement de mettre un terme à l’exploitation. Et cela, même si pour l’instant, son exploitation a été étendue à quelques reprises.
Deux scénarios peuvent être envisagés :
Le premier est une cession totale au secteur privé. les États se désengagent de la station totalement et transfèrent la responsabilité à une ou plusieurs entreprises. Reste à savoir sous quelle forme et sous quelles modalités : moyennant un échange de fonds ? De facto, il faudra abroger l’accord pour qu’il devienne un objet spatial privé comme un autre, comme un satellite lambda. Cela dit, il faudra quand même qu’il soit immatriculé par un État.
Si c’est une société américaine qui reprend les rênes, par exemple, elle devra faire immatriculer la station par son gouvernement et obtenir une autorisation de maîtrise de l’objet spatial dans l’espace de ce même gouvernement. De fait, il n’y aura plus de cadre international qui régira l’utilisation de l’ISS.
L’autre hypothèse est une sorte de partenariat public-privé. mais ça nécessiterait a priori une modification du traité existant pour insérer le partenaire privé dans l’accord et de préciser de nouvelles modalités de gestion et de gouvernance de la station. Cela dit, à ce stade, il n’y a pas de décision ferme qui a été prise pour la suite
Il n’est pas prévu d’exploiter ad vitam æternam la station. Il arrivera un jour où les nations décideront conjointement d’y mettre un terme.
Reste qu’il faudra bien se prononcer sur l’avenir de la station. Parce que si les États décident d’en stopper l’exploitation et qu’il y a pas de repreneur privé, cela implique un retour sur Terre, une opération qui comporte des difficultés techniques, parce qu’il s’agit d’une structure assez massive.
Même si la rentrée est contrôlée et qu’une bonne part de l’ISS sera détruite lors de son entrée dans l’atmosphère, cela reste une étape un peu sensible bien que réalisable techniquement.
Que se passerait-il si un crime ou délit est commis à bord ? Par exemple, si Thomas Pesquet avait tué Peggy Whitson ?
Il y a une disposition très claire dans l’accord. Le principe, c’est qu’en matière pénale, chaque État conserve la juridiction pénale sur ses propres ressortissants. Si on prend Thomas Pesquet, dans l’hypothèse où il commettrait un délit ou un crime dans la station, il serait soumis à la juridiction pénale française. Et cela, quel que soit l’endroit où se passerait l’infraction.
Il est toutefois prévu que l’État dont le ressortissant a commis un crime ou un délit doit consulter l’État qui est lésé, si ce dernier en fait la demande. Cet État peut exercer lui-même la juridiction pénale sur l’auteur du crime ou du délit, mais si l’une des deux conditions suivantes est remplie : si l’État du ressortissant donne son accord ou si cet État ne donne pas toutes les assurances qu’elle soumettra l’affaire à une autorité compétente.
Donc si Thomas Pesquet s’était « débarrassé » de Peggy Whitson, une astronaute américaine, le principe juridique qui est posé est que le jugement éventuel du spationaute relève de la juridiction française. Cela dit, les Américains peuvent demander à la France le droit de le juger, selon leur législation. Ceci ne sera possible que si la France donne son accord ou si la France paraît ne pas vouloir lui appliquer toutes les dispositions du Code pénal prévues à cet effet.
Cela dit, on n’imagine pas qu’en cas de crime en orbite, la France protège son spationaute au point de le soustraire à la loi. Dès lors, il est plausible de penser que Thomas Pesquet serait jugé en France, Paris voulant a priori que son ressortissant soit jugé par les tribunaux français. Laisser un spationaute français jugé selon le droit pénal d’un État étranger s’apparenterait à une forme d’extradition et la France refuse d’extrader ses propres ressortissants. Plus généralement, on peut penser que chaque État voudrait juger lui-même ses nationaux.
Cette question est d’ailleurs souvent posée, parce que l’hypothèse d’un assassinat dans la station fait toujours un peu fantasmer, mais le fait est que les États ont souhaité couvrir ce point expressément. Parce que s’il s’agit d’un questionnement théorique — ça n’est, bien sûr, jamais arrivé –, la survenue d’un tel évènement pourrait constituer un problème important dans la coopération. Au point peut-être d’altérer les relations diplomatiques entre les pays concernés.
Quelle serait la nationalité d’un bébé naissant à bord de l’ISS ?
Il faut d’abord noter qu’il y a quand même peu de chances qu’une agence spatiale envoie une femme enceinte en orbite. Cela dit, le questionnement juridique peut se poser. En premier lieu, si jamais elle tombait enceinte là-haut, à supposer que cela soit possible, on peut raisonnablement supposer que les agences la feraient redescendre sur Terre avant le terme.
Si ce n’est pas le cas, avec une naissance survenant effectivement à bord de l’ISS, il serait logique d’appliquer et d’articuler les différents droits de la nationalité des États, puisque les modules sont des extensions des territoires des nations participantes. Prenons un cas de figure pour être concret : une astronaute française qui est enceinte et qui accouche dans le module américain.
Si une naissance survenait à bord de l’ISS, il serait logique d’appliquer les différents droits de la citoyenneté
On va appliquer le droit de la nationalité américaine et celui de la nationalité française. Que dit le droit américain ? Il applique le droit du sol : tout bébé qui naît sur le territoire américain est Américain. Dans cette hypothèse, le bébé de l’astronaute française qui naîtrait dans le module américain serait donc Américain par droit du sol.
Mais il faut aussi considérer le droit français : en la matière, il est dit qu’un bébé né d’au moins un parent français est Français, même à l’étranger. C’est le droit du sang. Et comme la double-nationalité est permise entre la France et les États-Unis, puisqu’il existe une convention à ce sujet, le bébé aurait les deux nationalités, française et américaine.
Pourrait-on se marier à bord de l’ISS ?
Aussi étonnant que cela puisse paraître, il y a presque eu une forme de précédent en 2003, puisque le cosmonaute russe Iouri Malentchenko s’est marié, alors qu’il était à bord de la station, avec sa compagne qui se trouvait, elle, à Houston, au Texas. Je dis « presque » parce que cette union, d’un point de vue juridique, a eu lieu au Texas, selon le droit texan, qui autorise les mariages lorsque l’un des époux est absent.
Théoriquement, un mariage réellement effectué à bord de la station pourrait également avoir lieu, dans la mesure où l’on est censé pouvoir accomplir tous les actes de la vie civile en orbite puisqu’on est sur des prolongements de territoires terrestres. Donc oui, on pourrait se marier à bord de la station. Cela étant, il faut quand même respecter les procédures qui existent sur Terre.
En France, par exemple, il faut passer devant un officier d’État civil, qui est habilité à cet effet. Je ne suis pas certain qu’à bord, il y ait un astronaute qui dispose du pouvoir de marier deux personnes. Et je ne suis pas persuadé non plus qu’on puisse le faire par visioconférence, du moins en droit français. Donc en pratique, mettre en œuvre les procédures de mariage propres à chaque État dans l’espace, ça me paraît un peu compliqué.
+ rapide, + pratique, + exclusif
Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.
Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.
Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci
Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.
C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.
Mais si vous le pouvez,
voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :
- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.
- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.
- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.
Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil
Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !